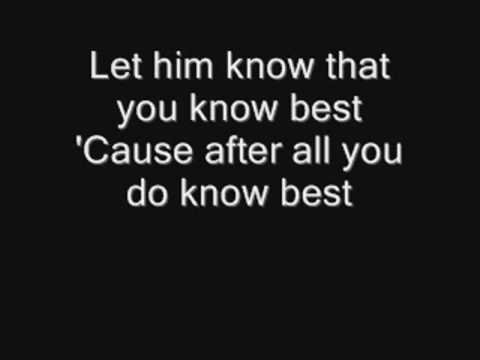“Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clef du trousseau qui ouvre la porte.”
Paulo Coelho
Le plus difficile dans le fait d’avoir une maladie dite mentale, ce n'était pas de l'admettre. Quoique, c'était là bien délicate affaire. Mais le plus difficile n'en demeurait pas moins le regard des autres. Savoir que l’on attendait de nous que l’on agisse comme si nous n’étions pas malades, quand bien même nous l’étions.
— J’ai besoin de votre aide, déclara fermement Elizabeth en poussant les lourdes portes du grand amphithéâtre dans lequel elle avait un jour récité Shakespeare.
La lumière que dispensaient ici et là les projecteurs la déstabilisa un court instant.
— Elizabeth ?
— J’ai besoin de votre aide, répéta-t-elle. Le soir du bal, vous avez dit que si j’avais besoin de vous, vous seriez là pour moi. Je participerai à votre pièce et je jouerai Ophélia, si c’est ce que vous voulez. Mais avant, il faut que vous m’aidiez. S’il vous plaît.
L’enseignante, prise au cœur par la voix hagarde quoique pressante de la jeune fille, la conduisit en salle des professeurs où elles purent siroter une tasse de thé. Mais les idées fusaient dans la tête de la jeune femme, et il lui devint bien ardue tâche de se faire comprendre. Ses mots, pourtant parfaitement intelligents, donnèrent lieu à un discours inintelligent, fait de maux qu'elle-même ne comprenait plus. Elle ne baissa pas les bras. Une heure s’écoula.
De nombreux professeurs défilèrent ce matin-là. Certains, heureux de retrouver la bonne élève, vinrent les interrompre pour prendre de ses nouvelles. D’autres, plus curieux, se contentèrent de tendre l’oreille, de capturer quelques bribes, sans grands sens une fois tirées hors de leur contexte, et de voler quelques pensées mal accordées.
Ethan, Monsieur Kwats en l'occurrence, fit lui aussi son apparition. Court caméo dans un long, très long métrage.
S’il ne pouvait lui adresser la parole, il savait sa bien-aimée angoissée et, par conséquent, il savait ce qu’il lui restait à faire. Si elle pouvait l’apercevoir, ne serait-ce qu’une minute ou deux avant de repartir au bras de Madame Bardle, cela suffirait à la calmer. Wingley leur était hostile. Les regards étaient comptés, comparés, critiqués. Les respirations, elles, étaient chronométrées, calculées avec minutie. Les touchés bannis. Interdits. Les mains se frôlaient alors en secret et les sourires se volaient lors des pauses. Ils avaient renouvelé leurs moyens de communication. Était finalement venu un temps où nécessité était faite de trouver une langue où la langue n’était pas requise. Parce qu’il enseignait, et qu’elle en saignait. Alors, ils tapaient. Ils tapaient du bout des doigts sur les bureaux. Ils tapaient du pied lorsque c’était trop.
Tap tap tap était leur nouveau je t’aime.
— Allons-y. Je suis prête, déclara-t-elle en lissant les plis de sa jupe.
Elizabeth n’était pas prête. Sa voix chancelait, ses mains tremblaient. Ça ne pouvait pas fonctionner, pas tant qu’elle était ainsi. L’enseignante, consciente de cela, lui demanda de fermer ses yeux et de penser à quelque chose d’agréable. Elizabeth n’eut pas grand mal à puiser dans ses souvenirs pour en trouver un joyeux. À vrai dire, il ne lui suffi que de lui. Lui, qu’elle entendait s’excuser auprès de la machine à café après s’y être cogné. Lui, qu’elle entendait parler poésie avec un collègue passionné d’histoire. Lui, qu’elle voyait lui dire son amour du matin au soir et lui prouver du soir au matin. Les respirations erratiques, les grains de beauté pudiques, les murmures illogiques, les surnoms anachroniques, sous des draps anesthésiques où la fusion était opioïdes, étaient encore là.

YOU ARE READING
Rendez-vous salle 209
RomanceÀ l'époque de Victor Hugo, on l'appelait le mal du siècle. Baudelaire lui, l'appelait le spleen. Les musiciens quant à eux, l'appellaient le blues. D'autres encore l'appelaient le cafard, le chagrin, ou encore la mélancolie. Elizabeth quant à elle d...